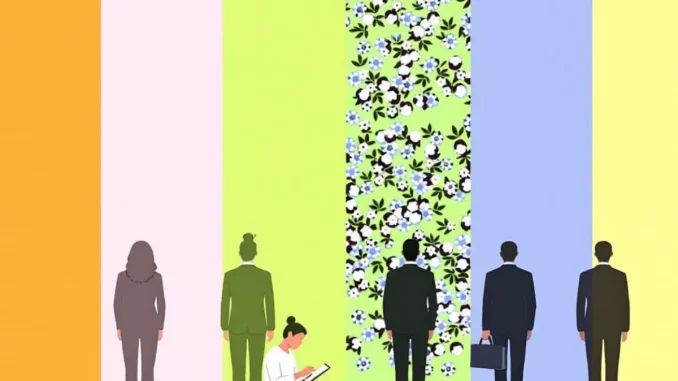
Face à l’urgence climatique mondiale, la question de la responsabilité des États dans la lutte contre le changement climatique s’impose comme un enjeu juridique majeur du XXIe siècle. Depuis l’Accord de Paris en 2015, un cadre normatif international se dessine progressivement, établissant des obligations pour les États tout en soulevant des questions fondamentales sur leur mise en œuvre effective. Entre contentieux climatiques en plein essor, responsabilité historique des nations industrialisées et émergence de nouveaux droits fondamentaux liés au climat, le droit de la responsabilité climatique des États constitue un domaine juridique en pleine mutation, à la croisée du droit international public, du droit de l’environnement et des droits humains.
Fondements Juridiques de la Responsabilité Climatique Étatique
La responsabilité climatique des États s’enracine dans plusieurs sources juridiques qui, bien que diverses, forment un socle normatif de plus en plus cohérent. Au premier rang figure la Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC) adoptée en 1992, qui reconnaît dans son article 2 l’objectif de stabilisation des concentrations de gaz à effet de serre à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique. Ce texte fondateur pose le principe des «responsabilités communes mais différenciées», reconnaissant que tous les États doivent agir contre le changement climatique tout en tenant compte de leurs capacités respectives et de leur contribution historique au problème.
L’Accord de Paris de 2015 représente une avancée majeure en établissant un cadre juridique plus contraignant. Son article 4 impose aux États de communiquer leurs «contributions déterminées au niveau national» (CDN) et de prendre des mesures pour les atteindre. Si ces engagements restent volontaires dans leur définition, leur mise en œuvre constitue une obligation juridique internationale. Le mécanisme de révision quinquennale des engagements instaure une dynamique d’amélioration continue qui renforce progressivement la responsabilité des États.
Au-delà des traités spécifiques au climat, le droit international coutumier offre des fondements complémentaires. Le principe «sic utere tuo ut alienum non laedas» (utilise ton bien de manière à ne pas nuire à autrui) a été confirmé dans l’affaire de la Fonderie de Trail (1941) puis dans la Déclaration de Stockholm de 1972. Ce principe établit qu’un État ne peut permettre l’utilisation de son territoire d’une manière qui cause des dommages à d’autres États, une règle désormais applicable aux émissions de gaz à effet de serre transfrontalières.
Les principes structurants de la responsabilité climatique
Plusieurs principes fondamentaux structurent cette responsabilité:
- Le principe de précaution, qui exige des mesures préventives même en l’absence de certitude scientifique absolue
- Le principe pollueur-payeur, qui attribue les coûts des dommages environnementaux à ceux qui les causent
- Le principe d’équité intergénérationnelle, qui impose de préserver l’environnement pour les générations futures
La jurisprudence internationale commence à donner corps à ces principes. L’avis consultatif de la Commission interaméricaine des droits de l’homme (OC-23/17) a confirmé que les États ont l’obligation de prévenir les dommages environnementaux transfrontaliers significatifs. De même, l’avis consultatif rendu en 2023 par la Cour internationale de Justice sur les obligations des États en matière de changement climatique renforce cette architecture juridique en précisant la portée des obligations étatiques.
Ces fondements juridiques, bien qu’encore en développement, constituent le socle sur lequel repose la responsabilité climatique des États. Ils permettent d’établir des obligations de plus en plus précises, dont la violation peut désormais engager la responsabilité internationale des États, ouvrant ainsi la voie à des mécanismes de sanctions et de réparation.
L’Émergence du Contentieux Climatique: Un Levier d’Action Novateur
Le contentieux climatique représente aujourd’hui l’un des développements les plus dynamiques du droit de la responsabilité climatique. Face à l’insuffisance des engagements étatiques, les tribunaux nationaux et internationaux sont de plus en plus sollicités pour contraindre les États à respecter leurs obligations climatiques. L’affaire Urgenda contre Pays-Bas (2019) constitue un précédent historique: pour la première fois, un tribunal national – la Cour suprême des Pays-Bas – a ordonné à un État de renforcer ses objectifs de réduction d’émissions de gaz à effet de serre, sur le fondement du devoir de diligence de l’État et des articles 2 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Cette jurisprudence fondatrice a inspiré une vague de contentieux similaires à travers le monde. En France, l’affaire Grande-Synthe (2021) a vu le Conseil d’État reconnaître l’insuffisance des mesures prises par l’État français pour atteindre ses objectifs climatiques. Dans l’affaire du Siècle, les juridictions françaises ont reconnu l’existence d’un «préjudice écologique» résultant de l’inaction climatique de l’État. En Allemagne, la Cour constitutionnelle fédérale a jugé en 2021 que la loi climatique allemande violait les droits fondamentaux des générations futures en reportant l’essentiel des efforts de réduction après 2030.
Au niveau supranational, la Cour européenne des droits de l’homme a été saisie de plusieurs affaires climatiques, dont Duarte Agostinho et autres c. Portugal et 32 autres États, dans laquelle des jeunes portugais allèguent que l’inaction climatique des États européens viole leurs droits fondamentaux. Cette affaire pourrait établir un précédent majeur en matière de responsabilité climatique transnationale.
Les fondements juridiques invoqués dans les contentieux climatiques
Les contentieux climatiques s’appuient sur une diversité de fondements juridiques:
- La violation des engagements internationaux pris dans le cadre de l’Accord de Paris
- Le non-respect du droit national en matière climatique
- La violation des droits fondamentaux, notamment le droit à la vie et le droit à un environnement sain
- Le manquement au devoir de vigilance ou de diligence de l’État
Ces contentieux présentent plusieurs caractéristiques novatrices. D’abord, ils adoptent souvent une approche intergénérationnelle, les requérants agissant au nom des générations futures. Ensuite, ils mobilisent des preuves scientifiques complexes, notamment les rapports du GIEC, pour établir le lien de causalité entre l’inaction étatique et les dommages climatiques. Enfin, ils conduisent à l’émergence de nouvelles formes de réparation, comme l’injonction à adopter des politiques climatiques plus ambitieuses.
Malgré ces avancées, le contentieux climatique se heurte à plusieurs obstacles: la question de la causalité entre les émissions d’un État particulier et des dommages spécifiques reste complexe; la justiciabilité des engagements internationaux n’est pas unanimement reconnue; et l’exécution des décisions judiciaires peut s’avérer difficile face à la résistance des gouvernements. Néanmoins, ces contentieux contribuent indéniablement à la cristallisation progressive d’obligations climatiques juridiquement contraignantes pour les États.
Responsabilité Différenciée et Justice Climatique: Un Équilibre à Trouver
La notion de responsabilité différenciée constitue l’une des pierres angulaires du régime juridique climatique international. Ce concept, formalisé dans le principe des «responsabilités communes mais différenciées» de la CCNUCC, reconnaît que tous les États doivent contribuer à la lutte contre le changement climatique, mais que cette contribution doit être modulée selon leur responsabilité historique dans les émissions de gaz à effet de serre et leurs capacités économiques et technologiques.
Cette approche différenciée se justifie par plusieurs facteurs. D’abord, les pays développés ont émis historiquement la majeure partie des gaz à effet de serre depuis la révolution industrielle. Une analyse des données du Global Carbon Project montre que les États-Unis et l’Union européenne sont responsables de plus de 50% des émissions cumulées de CO2 depuis 1850, alors qu’ils ne représentent qu’environ 10% de la population mondiale actuelle. Cette dette carbone historique fonde une responsabilité particulière des nations industrialisées.
Ensuite, les capacités techniques et financières varient considérablement entre les États. Le principe d’équité exige que les pays disposant de ressources plus importantes assument une part plus conséquente de l’effort global. Cette différenciation se traduit juridiquement par des obligations distinctes: l’Accord de Paris maintient cette approche tout en l’assouplissant, avec un système d’engagements nationaux volontaires mais universels, complété par des obligations de soutien financier et technologique des pays développés vers les pays en développement.
Les mécanismes de solidarité et de compensation
La responsabilité différenciée s’incarne dans plusieurs mécanismes concrets:
- Le Fonds vert pour le climat, qui vise à mobiliser 100 milliards de dollars par an pour financer l’atténuation et l’adaptation dans les pays en développement
- Le mécanisme de Varsovie sur les pertes et préjudices, qui aborde la question des dommages irréversibles causés par le changement climatique
- Les transferts de technologies prévus par l’article 10 de l’Accord de Paris
La COP27 de Charm el-Cheikh a marqué une avancée significative avec l’accord sur la création d’un fonds spécifique pour les «pertes et dommages», reconnaissant formellement la responsabilité des pays développés dans la compensation des préjudices subis par les nations les plus vulnérables.
Cette approche différenciée soulève néanmoins des défis juridiques considérables. D’abord, la montée en puissance des économies émergentes comme la Chine et l’Inde, désormais parmi les plus grands émetteurs mondiaux, remet en question la dichotomie traditionnelle entre pays développés et en développement. Ensuite, la quantification précise de la responsabilité historique et la détermination de seuils temporels pertinents font l’objet de controverses. Enfin, l’articulation entre responsabilité différenciée et souveraineté nationale reste délicate, certains États invoquant leur droit au développement pour limiter leurs engagements climatiques.
La jurisprudence commence à apporter des éclaircissements sur ces questions. Dans l’affaire Neubauer et al. c. Allemagne, la Cour constitutionnelle allemande a reconnu la nécessité de tenir compte du budget carbone global restant et de sa répartition équitable entre nations. Cette approche, fondée sur une conception de la justice distributive à l’échelle planétaire, pourrait influencer l’évolution future du droit de la responsabilité climatique des États.
L’Interface Entre Responsabilité Climatique et Droits Humains
L’interaction entre changement climatique et droits humains constitue l’un des développements les plus significatifs du droit de la responsabilité climatique. Une évolution jurisprudentielle et doctrinale majeure reconnaît désormais que les perturbations climatiques menacent directement la jouissance effective de nombreux droits fondamentaux. Le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies a adopté en 2021 la résolution 48/13 reconnaissant le droit à un environnement propre, sain et durable comme un droit humain à part entière, consolidant ainsi le lien juridique entre protection du climat et droits fondamentaux.
Cette convergence s’observe dans plusieurs catégories de droits particulièrement affectés par le dérèglement climatique. Le droit à la vie, protégé par l’article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, est directement menacé par l’intensification des phénomènes météorologiques extrêmes. Le Comité des droits de l’homme des Nations Unies a reconnu cette menace dans l’affaire Teitiota c. Nouvelle-Zélande (2020), où il a admis que les effets du changement climatique pouvaient créer une obligation de non-refoulement pour les personnes fuyant des territoires devenus inhabitables.
Le droit à la santé, consacré par l’article 12 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, est compromis par la propagation de maladies vectorielles, les vagues de chaleur et la pollution atmosphérique aggravée par le réchauffement. Le droit à l’alimentation et le droit à l’eau sont menacés par les sécheresses, les inondations et la désertification qui réduisent les rendements agricoles et contaminent les ressources hydriques.
Les obligations positives des États en matière climatique
Cette approche par les droits humains génère des obligations positives pour les États:
- L’obligation de protéger leurs populations contre les atteintes aux droits fondamentaux résultant du changement climatique
- L’obligation de prévention, qui impose l’adoption de mesures d’atténuation suffisantes
- L’obligation procédurale d’information et de participation du public aux décisions climatiques
Ces obligations ont été progressivement précisées par la jurisprudence. Dans l’affaire Leghari c. Pakistan (2015), la Haute Cour de Lahore a jugé que l’inaction du gouvernement pakistanais face au changement climatique violait les droits fondamentaux des citoyens, notamment le droit à la vie. La Commission interaméricaine des droits de l’homme a reconnu dans son avis consultatif OC-23/17 que le droit à un environnement sain implique des obligations positives pour les États en matière de lutte contre le changement climatique.
Une attention particulière est accordée aux groupes vulnérables, disproportionnellement affectés par les impacts climatiques: populations autochtones, enfants, personnes âgées et habitants des zones côtières ou insulaires. La Cour européenne des droits de l’homme examine actuellement l’affaire Association des Aînées pour la protection du climat c. Suisse, qui allègue que l’inaction climatique du gouvernement suisse discrimine particulièrement les femmes âgées, plus vulnérables aux vagues de chaleur.
Cette convergence entre droits humains et droit climatique présente l’avantage considérable de s’appuyer sur des mécanismes juridictionnels établis et efficaces. Elle permet de concrétiser les obligations climatiques des États et de les rendre justiciables devant les tribunaux nationaux et internationaux. Toutefois, elle soulève aussi des questions complexes sur l’extraterritorialité des obligations en matière de droits humains et sur la mesure dans laquelle un État peut être tenu responsable des effets climatiques affectant des populations au-delà de ses frontières.
Vers un Régime Juridique Intégré de Responsabilité Climatique
L’évolution récente du droit de la responsabilité climatique des États témoigne d’une tendance à la consolidation et à l’intégration des différentes sources normatives. Cette dynamique d’intégration se manifeste à plusieurs niveaux et pourrait aboutir à l’émergence d’un véritable régime juridique cohérent de responsabilité climatique.
Au niveau international, on observe une intensification des interactions entre les différents systèmes juridiques. Le droit international de l’environnement, le droit international des droits humains et le droit international économique convergent progressivement autour des questions climatiques. Cette convergence se traduit notamment par l’incorporation de considérations climatiques dans les accords commerciaux, comme l’illustre le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières de l’Union européenne, qui vise à prévenir les «fuites de carbone» tout en respectant les règles de l’Organisation mondiale du commerce.
La question de la responsabilité transfrontalière constitue un enjeu central de cette évolution. Les émissions de gaz à effet de serre ne connaissant pas de frontières, leurs effets se font sentir bien au-delà du territoire des États émetteurs. Cette réalité physique pousse à repenser les concepts traditionnels de juridiction et de responsabilité en droit international. L’avis consultatif de 2023 de la Cour internationale de Justice apporte des précisions importantes sur la portée extraterritoriale des obligations climatiques des États.
Les innovations juridiques émergentes
Plusieurs innovations juridiques prometteuses émergent dans ce contexte:
- Le développement de mécanismes de transparence et de redevabilité renforcés, comme le «cadre de transparence renforcé» de l’Accord de Paris
- L’élaboration de standards de diligence spécifiques au domaine climatique
- La reconnaissance progressive d’une obligation de résultat en matière de réduction des émissions, dépassant la simple obligation de moyens
L’intégration entre niveaux national et international s’accentue également. Les constitutions nationales intègrent de plus en plus des dispositions relatives à la protection du climat, comme l’a fait la France avec la Charte de l’environnement de 2004. Les lois-cadres climatiques nationales, telles que le Climate Change Act britannique de 2008 ou la Loi climat et résilience française de 2021, créent des obligations juridiques précises pour les gouvernements, souvent assorties de mécanismes de contrôle indépendants.
La responsabilité climatique s’étend désormais au-delà des seuls États. Les entreprises multinationales font l’objet d’obligations croissantes en matière de reporting climatique et de réduction de leur empreinte carbone. La directive européenne sur le devoir de vigilance impose aux grandes entreprises d’identifier et de prévenir les risques climatiques dans leurs chaînes de valeur. Cette extension de la responsabilité aux acteurs non-étatiques complète le régime de responsabilité étatique.
Malgré ces avancées, des défis juridiques majeurs persistent. La question de la réparation des dommages climatiques reste particulièrement épineuse: comment quantifier financièrement des préjudices diffus, cumulatifs et parfois irréversibles? Le lien de causalité entre les émissions spécifiques d’un État et des dommages particuliers demeure difficile à établir avec certitude. Enfin, l’effectivité des sanctions en cas de non-respect des obligations climatiques constitue un enjeu central pour la crédibilité du régime juridique en construction.
Néanmoins, l’intégration progressive des diverses sources normatives et l’émergence de principes communs laissent entrevoir la formation d’un véritable corpus juris du climat. Ce régime juridique en construction pourrait constituer l’une des innovations majeures du droit international contemporain, répondant à l’urgence d’une menace globale par des solutions juridiques adaptées à sa nature transfrontalière et intergénérationnelle.
Perspectives d’Avenir: Renforcement et Effectivité de la Responsabilité Climatique
L’avenir du droit de la responsabilité climatique des États se dessine à travers plusieurs tendances émergentes qui pourraient transformer profondément ce domaine juridique. Les évolutions récentes suggèrent un renforcement progressif des obligations étatiques, accompagné d’une recherche accrue d’effectivité dans leur mise en œuvre.
La première tendance majeure concerne le durcissement des obligations substantielles. Les engagements volontaires de l’Accord de Paris évoluent graduellement vers des obligations de résultat plus contraignantes. Le Pacte de Glasgow pour le climat adopté lors de la COP26 a établi un mécanisme de révision annuelle des engagements nationaux, accélérant la dynamique de renforcement progressif. Les tribunaux jouent un rôle catalyseur dans cette évolution, comme l’illustre la décision du Tribunal administratif de Paris dans l’affaire du Siècle (2021), qui a reconnu l’existence d’un «préjudice écologique» résultant de l’inaction climatique de l’État français.
La deuxième tendance porte sur le développement des mécanismes de contrôle et de sanction. Le Comité d’application et de respect des dispositions de l’Accord de Paris, bien que non punitif, représente une première étape vers un contrôle international plus systématique. Au niveau régional, l’Union européenne renforce ses mécanismes de gouvernance climatique, avec la possibilité pour la Commission d’engager des procédures d’infraction contre les États membres ne respectant pas leurs obligations climatiques. La Cour de justice de l’Union européenne pourrait jouer un rôle croissant dans l’interprétation et l’application du Pacte vert européen.
Les défis à relever pour une responsabilité climatique effective
Plusieurs défis majeurs devront être relevés pour renforcer l’effectivité du régime juridique:
- La coordination entre ordres juridiques nationaux, régionaux et internationaux
- L’adaptation des règles de preuve aux spécificités des dommages climatiques
- Le développement de mécanismes financiers adéquats pour la réparation des préjudices climatiques
Le concept de crime d’écocide, actuellement en discussion dans plusieurs enceintes internationales, pourrait constituer une avancée significative. Son intégration dans le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, comme le proposent certains États, créerait un nouveau niveau de responsabilité pour les atteintes les plus graves à l’environnement, y compris celles contribuant significativement au dérèglement climatique.
Le rôle des acteurs non-étatiques dans la mise en œuvre et le contrôle de la responsabilité climatique semble appelé à se renforcer. Les organisations non gouvernementales jouent un rôle croissant dans le contentieux climatique, comme l’illustre l’action de ClientEarth ou de la Fondation Urgenda. Les investisseurs institutionnels exercent une pression financière sur les États, notamment via les obligations vertes souveraines dont les conditions peuvent être liées au respect d’engagements climatiques.
L’évolution technologique offre de nouvelles perspectives pour le contrôle des obligations climatiques. Les systèmes de mesure satellitaire des émissions, comme ceux développés par l’Agence spatiale européenne, permettent une vérification indépendante des données nationales. Les technologies de blockchain pourraient sécuriser les registres d’émissions et les échanges de quotas carbone, renforçant la transparence du système.
À plus long terme, la question se pose d’une possible institutionnalisation renforcée de la gouvernance climatique mondiale. La création d’une Organisation mondiale de l’environnement dotée de pouvoirs contraignants, proposée par plusieurs experts et certains États, pourrait transformer radicalement le paysage juridique de la responsabilité climatique. De même, l’établissement d’une Cour internationale du climat, compétente pour trancher les différends climatiques entre États et potentiellement recevoir des plaintes individuelles, représenterait une innovation majeure.
Ces perspectives d’avenir dessinent un régime juridique de responsabilité climatique en profonde mutation. Si les incertitudes demeurent nombreuses, la trajectoire générale semble orientée vers un renforcement progressif des obligations étatiques et une recherche accrue d’effectivité. Cette évolution répond à l’urgence de la situation climatique mondiale et à la nécessité d’adapter les cadres juridiques traditionnels à ce défi sans précédent. Le droit de la responsabilité climatique des États, encore émergent il y a quelques années, s’affirme ainsi comme un domaine juridique stratégique pour l’avenir de nos sociétés et de la gouvernance mondiale.
